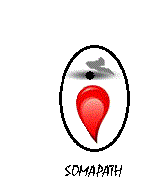Entrées avec Titre commençant par 'P'
Particularités cliniques et hématologiques de l’anémie par carence en vitamine B12 dans un hôpital de dernier recours au Mali.
Yacouba Lazare DIALLO1, Boubacar Ali TOURE2, Madani LY3, Yacouba CISSOKO4, SOW Djeneba SYLLA1, Nanko DOUMBIA1, MENTA Djenebou TRAORE1, Madani OUOLOGUEM1, Nouhoum OUOLOGUEM1, Massama KONATE1, SIDIBE Assa TRAORE1.
Le diagnostic de l’anémie par carence en vitamine B12 est fait par le dosage sérique de la vitamine. Ce travail décrit les particularités cliniques de la carence en vitamine B12 au Mali.
Sur 79 dossiers, 52 cas d’anémie par carence en vitamine B12 , ont été retenus du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2012. Nous avons étudié les paramètres cliniques et biologiques. Un taux de vitamine B12 inférieur à 200 pg/ml, était le principal critère d’inclusion. Le dosage de la vitamine B12 sérique a été fait selon la technique ELISA. L’analyse statistique a été faite sur SPSS 12.0.
Nous avons retenus 52 dossiers. L’âge moyen était de 52,1±14,7 ans (extrêmes : 10 et 81 ans). Le sex-ratio H/F était de 0,9. Soixante pour cent (60%) des patients avaient moins de 60 ans. L’anémie était retrouvée chez 94,2% des patients. L’examen clinique, notait une mélanodermie chez 46,2% des malades, des signes neurologiques (52% des malades). Le volume globulaire moyen était de 96,5 fl (extrêmes : 70 et 143 fl). Le taux moyen de vitamine B12 sérique était de 81,5 pg/ml (extrêmes : 2,1 et 197,3 pg/ml). La fibroscopie réalisée chez 27 malades, retrouvait des lésions de la muqueuse gastrique (17 fois).
Nous concluons, que l’anémie par carence en vitamine B12 présente des caractéristiques cliniques et hématologiques particulières qui doivent être connues en vue d’améliorer sa prise en charge au Mali.
Perturbations hématologiques associées à la sévérité et à la mortalité de la COVID-19 : étude monocentrique sur 90 cas colligés à Ouagadougou
Sawadogo Salam1, Diendéré Eric Arnaud2,3, Djoki Edou Jérémie Luc2, Nébié Koumpingnin1, Traoré Catherine4, Koulidiati Jérôme1,3, Tiéno Hervé3, Kafando Eléonore1.
L'objectif de notre étude était de décrire les perturbations hématologiques au cours de la COVID-19 et leur association avec la sévérité et la mortalité de la maladie.
Nous avons conduit une étude transversale qui a inclus des patients atteints de COVID-19 et hospitalisés entre juillet 2020 et août 2021 au Centre Hospitalier Universitaire Bogodogo à Ouagadougou. Nous avons analysé les données socio-démographiques, cliniques, les résultats des examens hématologiques et calculé l’index systemic immune inflammation (SII) et les ratios neutrophiles/lymphocytes (NLR), plaquettes /lymphocytes (PLR) et neutrophiles/plaquettes (NPR).
Sur 90 patients inclus, 58,9% étaient de sexe masculin avec un âge moyen de 56,9 ± 16,2 ans. Les formes sévères représentaient 58,9% et ont concerné des patients significativement plus âgés que dans les cas non-sévères (p = 0,005). Les principales anomalies de l’hémogramme étaient l’anémie (48,9%), l’hyperleucocytose (21,1%), la neutrophilie (24,4%) et la lymphopénie (58,9%). Les cas sévères avaient un nombre de leucocytes (p = 0,006) et de monocytes (p = 0,01) significativement plus élevé. La mortalité était associée au nombre de leucocytes (p = 0,0002), de neutrophiles (p = 0,0007), de monocytes (p = 0,003) ainsi qu’aux ratios NLR (p = 0,04), NPR (p = 0,03) et d’index SII (p = 0,02).
Conclusion : Notre étude montre que l’hémogramme, un test accessible et peu coûteux peut-être un examen de surveillance dans la COVID-19 dans notre contexte.
Place des anti-inflammatoires non steroïdiens dans les hémorragies digestives
Moussa Younoussou DICKO 1, Makan.Siré TOUNKARA1,, Drissa KATILE2, Kadiatou DOUMBIA épouse SAMAKE1, Houroumou SOW épouse COULIBALY1, Déborah SANOGO épouse SIDIBE3, Awa TRAORE1, Ganda SOUMARE3, Ouatou MALLE3, Abdoulaye MAIGA 3, Anselme KONATE1, Moussa TIÉMOKO DIARRA1, Moussa Youssoufa MAIGA 1
Le but principal de ce travail était d’étudier la place des AINS dans les hémorragies digestives dans le service d’hépato gastroentérologie.
Cette étude prospective et analytique s’est déroulée au centre hospitalier et universitaire Gabriel TOURE en un an et a porté sur les patients hospitalisés pour hémorragie digestive. Ces patients avaient bénéficié de la recherche des caractères sociodémographiques, de la notion de prise d’anti inflammatoire non stéroïdien (Dose et durée), d’un examen physique et d’une endoscopie digestive.
Au terme de cette étude, une fréquence hospitalière de 36,4% a été retrouvée. L’âge moyen des patients était de 44,9±17,5 ans avec un sex-ratio de 3. Les femmes au foyer et les ouvriers étaient les plus touchées. L’hématémèse était le motif de consultation dans 77,3% des cas. L’hémorragie digestive et le tabagisme étaient les antécédents les plus retrouvés. L’hémorragie survenait significativement dans la 1ère semaine de la prise d’anti inflammatoire non stéroïdien, p < 0,0001 et était significativement associée à la prise du Diclofénac, p < 0,0001 et de l’Ibuprofène, p = 0,017. L’hypotension artérielle, la pâleur et la tachycardie étaient les signes de choc hémorragique retrouvés respectivement dans 75% ; 68,2% et 45,5% des cas. L’anémie était associée à l’augmentation de la créatinine et à la cytolyse dans respectivement 40,5% et 33,3% des cas. L’ulcère était la cause retrouvée dans 68,4%. Nous avons constaté une mortalité globale de 11,4% sans différence significative entre les molécules et la survenue du décès.
Conclusion : L’hémorragie digestive, principale urgence digestive, demeure une cause de morbi-mortalité importante.
Pratique de la fibroscopie œsogastroduodénale (FOGD) au Centre de Santé de Reference (CSREF) de Koutiala : à propos de 209 cas.
Abdoulaye MAIGA 1, Ganda SOUMARE 2, Saran Déborah SANOGO Epouse SIDIBE2, Ouatou MALLE 2, Hamadoun GUINDO 3, Moussa Younoussa DICKO3, Youssouf KASSAMBARA 3, Makan Sire TOUNKARA 3, , Drissa KATILE 3, , Kadiatou SAMAKE épouse DOUMBIA 3, Hourouma SOW Epouse COULIBALY 3, Youssouf Diam SIDIBE4, Madina TALL Epouse MAIGA4, Hassana TAPILY4, Amadou dit Aphou DRAGO 5.
La fibroscopie œsogastroduodénale (FOGD) est une méthode d’exploration visuelle de la partie haute du tube digestif par l’intermédiaire d’un tube optique muni d’un système d’éclairage appelé endoscope ou fibroscope. Cet examen permet l’exploration directe de la muqueuse de l’œsophage, de l’estomac et du duodénum afin de déceler les anomalies et d’effectuer des prélèvements. Elle est à la fois diagnostic et thérapeutique.
Notre étude avait pour but d’évaluer la pratique de la fibroscopie œsogastroduodénale au Centre de Santé de Référence de Koutiala.
Nous avons réalisé une étude transversale sur les résultats de FOGD au CSRef de Koutiala de Juin 2017 à Mai 2019, soit une période de 24 mois.
La fibroscopie a été réalisée chez 209 patients dont 115 hommes et 94 femmes. Le sex ratio était de 1,22. L’âge moyen des était de 41,80 ans ± 14,4 avec des extrêmes à 15 ans et 93ans. Les épigastralgies représentaient 49% des indications. La FOGD était normale dans 36 % des cas. Les pathologies gastriques représentaient 38,7% (gastrite chronique à Hp 14,8%, ulcère 9,5% et adénocarcinome 4,8%) suivies des pathologies œsophagiennes, 19,1%. (Œsophagite 7,1%, varices œsophagiennes 4,8% et du carcinome épidermoïde 3,3%).
Conclusion : La pratique de la FOGD au CSRef de Koutiala a permis d’explorer le tube digestif haut et de contribuer ainsi au diagnostic de lésions œsogastroduodénales.
Pratique transfusionnelle dans une unité d’oncologie pédiatrique
DOUMBIA Abdoul Karim1, KANE Bourama2, TOGO Pierre1, COULIBALY Oumar1, FANE Seydou1, SACKO Karamoko1, DEMBELE Adama1 , CISSE Mohamed E.1, DIALL Hawa1, MAÏGA Belco1, DIAKITE Fatoumata L.1 KONATE Djeneba1, TRAORE Issa1, DOUMBIA Aminata1, TOURE Amadou1, FANE Baba3, DEMBELE Guediouma2, DIAKITE Abdoul A.1, DICKO Fatoumata T.1, TOGO Boubacar1, SYLLA Mariam1
L’objectif de ce travail était d’étudier la pratique transfusionnelle à l’unité d’oncologie pédiatrique (UOP) de Bamako.
Il s’agissait d’une étude prospective, descriptive allant du 1ermars au 31 septembre 2016. Nous avons inclus 50 patients atteints de cancer ayant reçu une transfusion sanguine au cours de leur séjour hospitalier.
Les enfants âgés de moins de 5 ans représentaient 48 % de la population étudiée. Le sex-ratio était de 1,8. Soixante-dix pour cent (70%) résidaient à Bamako. Les leucémies aiguës représentaient 38 % des diagnostics, les lymphomes (24 %), le néphroblastome (14 %) et le rétinoblastome (14 %). Une transfusion antérieure était notée chez 52 % des enfants. Une anémie sévère était observée chez 88% des patients et 41% avaient un risque de saignement. La toxicité de la chimiothérapie était la principale indication de la transfusion. Le taux d’hémoglobine moyen était de 6 g/dl avec des extrêmes de 3 et 11g/dl. Ce taux était inférieur à 8g/dl chez 88% des patients. La leucopénie était présente chez 28% des patients et une thrombopénie inférieure à 50000 chez 41% des patients.
Le groupe sanguin A était demandé dans 48 %, le rhésus positif dans 90 % des cas. La majorité des demandes était formulée avant 16 h 00 de la journée. Le produit sanguin labile (PSL) était acheminé à la main dans 50% des cas. Le concentré érythrocytaire était administré chez 68% des patients. Le délai d’obtention du PSL dépassait 24 heures dans 10 % des cas. Le temps d’administration du produit sanguin était de 4 à 5 heures dans 64 % des cas. Aucun accident transfusionnel n’avait été signalé. Une amélioration clinique était observée chez 98 % des patients.
Conclusion: Cette étude est une première dans notre service. La mise en œuvre de lignes directrices pourrait améliorer la pratique transfusionnelle chez les enfants atteints de cancer.
Prescription des produits sanguins labiles et satisfaction des besoins: quelle qualité au Centre National de Transfusion Sanguine de Bamako ?
DIARRA Amadou B1, SEMEGA Cheick Hamallah1, CISSE Moussa1, GUITTEYE Hassana1, TRAORE Djakaridja1, TRAORE Adama1, FOMBA Minkoro1,TOGORA Gaoussou1, KAMISSOKO N’Falaye1, BA Alhassane1, KOURIBA Bourèma2
L’objectif de ce travail était d’évaluer la qualité de la prescription des produits sanguins labiles (PSL) et la satisfaction des besoins à Bamako.
Il s’agissait d’une étude descriptive rétrospective qui s’est déroulée de mars à décembre 2013 au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) de Bamako. Elle a porté sur 2620 demandes de PSL. L’unité d’étude était l’ordonnance. Nous avons sélectionné de façon systématique une ordonnance sur 2, tous les jours. Chaque ordonnance était suivie jusqu’à la délivrance de la totalité ou non des produits sanguins prescrits. Les informations ont été recueillies sur une fiche d’enquête et saisies et analysées sur SPSS 19.0.
Le sang total était prescrit dans 67% des cas. Les prescripteurs de sang étaient des médecins (72%), des internes, des étudiants en médecine, d’infirmiers et de sages-femmes. Un-tiers des ordonnances (31%) comportaient des non-conformités diverses indiquant la nécessité de former les prescripteurs des PSL des bonnes pratiques transfusionnelles. Les demandes de PSL en général étaient satisfaites à 61% dans un délai médian de 3 jours, ce qui est relativement long.
Conclusion : Cette étude met en exergue les insuffisances dans la prescription et le niveau relativement faible de la satisfaction des besoins des demandeurs de produits sanguins, indiquant la nécessité d’améliorer le processus tant au niveau du CNTS, qu’au niveau des structures de soins.